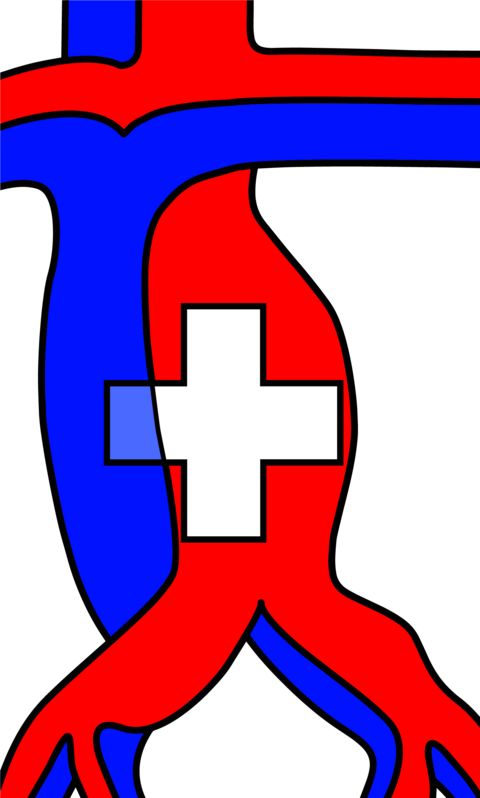Pour les amputations des pulpes digitales, le pansement en film fait partie du traitement standard. Grâce aux expériences positives, son indication s'est élargie au fil des ans [1]. Désormais, il est également utilisé en présence d’un os exposé, à condition que l’os saillant soit réduit au niveau des tissus mous [2]. Même les articulations exposées ne constituent plus une contre-indication [1]. En revanche, la prise en charge chirurgicale par différentes méthodes peut être complexe en raison de l’expertise requise en chirurgie de la main et de l’état souvent précaire des tissus mous [3].
Cas clinique
Anamnèse
Un touriste de 73 ans séjournant en Engadine s’est blessé à l’index gauche en manipulant l’hélice d’un modèle réduit d’avion. L’hélice s’est mise en marche accidentellement, provoquant une lésion de la partie radiale de la pulpe de l’index, avec atteinte partielle de la phalange intermédiaire radiale distale. La sensibilité est restée intacte. Le patient ne présentait pas d’antécédents médicaux significatifs.
Examen clinique
A l'examen clinique, on trouve un important défaut des tissus mous (A) sur la face radiale de la phalange distale du deuxième doigt gauche (main non dominante), ainsi qu’une plaie par coupure sur la face palmaire, au-dessus de l’articulation métacarpophalangienne. Le défaut tissulaire de la phalange distale concernait l’ongle et s’étendait au-delà de l’articulation, sans exposition osseuse. La sensibilité distale était intacte. La flexion active de l’articulation interphalangienne distale (DIP) était de 70°, et le mouvement était possible contre résistance dans toutes les articulations.
Résultats
Une radiographie de la main n’a montré aucune fracture récente, mais a révélé des signes évidents d’arthrose des articulations interphalangiennes distales des deuxième et troisième doigts.
Diagnostic et traitement
Cliniquement, il s’agissait d’un défaut des tissus mous traversant l’articulation (classification d’Allen IV [4]), sans exposition osseuse ni articulaire (Fig. 1, A). Une discussion a d’abord eu lieu au sein de l’équipe chirurgicale. L’argument en faveur d’une prise en charge chirurgicale était l’étendue du défaut dépassant l’articulation et la perte tissulaire correspondante. Une plastie en VY aurait été envisagée en première intention. En faveur du traitement conservateur, l’expérience positive avec le pansement en film, même pour des plaies étendues, a été prise en compte. De plus, les tendons étaient intacts, l’os n’était pas atteint et la plaie n’était pas fortement contaminée. Nous avons donc initié le traitement par pansement en film. Pour cela, l’index a été hermétiquement recouvert avec un film Opsite.
Application du pansement film
Si, après un examen approfondi, le choix se porte sur un traitement conservateur, la prise en charge débute par un nettoyage et un débridement de la plaie. La peau proximale au défaut doit être nettoyée et éventuellement dégraissée. En général, un film Opsite est utilisé, appliqué de manière circulaire environ 2 cm distalement à la plaie. Le film doit être hermétique, mais sans tension. Il est important de laisser un petit espace distalement pour l’écoulement du liquide de la plaie. Un bandage de protection peut être appliqué autour du film pour un meilleur confort. Le patient doit être informé du processus de guérison et du développement éventuel d’une odeur. Le pansement est changé tous les trois à sept jours, sans nécessiter de désinfection ni de débridement supplémentaire. Si le pansement devient non étanche, il doit être remplacé plus tôt. Afin d’éviter une raideur articulaire, l’immobilisation du doigt est déconseillée ; la mobilisation active et passive doit être encouragée et surveillée. Une prophylaxie antibiotique n’est généralement pas indiquée. Le traitement par pansement en film est poursuivi jusqu’à ce que la plaie soit sèche, c’est-à-dire après l’achèvement de l’épithélialisation, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Par la suite, un pansement de protection peut être utilisé si nécessaire pour un soutien mécanique. Pour des images illustratives, nous renvoyons aux travaux de Hoigné et Hug, publiés en 2014 [1,15].
Suivi
Le patient a été suivi par des spécialistes dans notre centre de soins des plaies, où des contrôles réguliers et des changements de pansement ont été effectués (Fig. 1, B-D). Il a porté le pansement en film pendant près de trois semaines, sans ressentir de douleur. Toutefois, il trouvait l’odeur très gênante et préférait rester à l’extérieur. Pour favoriser la cicatrisation et préserver la mobilité des articulations du doigt, il a suivi une rééducation de la main.
Sept mois après l’accident initial, le patient a été à nouveau pris en charge dans notre hôpital pour une autre raison. L’examen a révélé un résultat esthétique satisfaisant du traitement (Fig. 1, E-F). À première vue, aucune différence notable entre les doigts n’était perceptible. Un examen plus attentif a toutefois mis en évidence une légère anomalie avec une discrète striction et une asymétrie du repli unguéal. La sensibilité était intacte et la discrimination en deux points équivalente au côté opposé (3,5 mm). Il ne présentait aucune plainte liée aux variations de température.
Sur le plan fonctionnel, la flexion active et passive de l’articulation interphalangienne distale (DIP) était impossible. L’articulation était raide, mais indolore, et le patient ne ressentait aucune limitation dans sa vie quotidienne. L’articulation interphalangienne proximale (PIP) ne montrait aucune restriction fonctionnelle par rapport au côté opposé (flexion/extension 90°/0/0). Le patient continue à pratiquer le modélisme aéronautique comme loisir, mais fait preuve d’une prudence accrue avec les hélices tranchantes.
Discussion
Ce cas illustre de manière éloquente comment un défaut tissulaire étendu, traversant une articulation, peut aboutir à d’excellents résultats fonctionnels grâce à un traitement conservateur par pansement en film. Le pansement en film a été décrit pour la première fois en 1975, lorsqu’il a été observé que des amputations digitales pouvaient cicatriser avec des pansements à la graisse [5]. Quelques années plus tard, De Boer a introduit le pansement occlusif associé à la sulfadiazine d’argent [6]. Au fil des années, les matériaux ont continué d’évoluer. En 1993, Mennen et Wiese ont présenté le pansement semi-occlusif, utilisant pour la première fois le film Opsite. Grâce à cette occlusion sous une « peau artificielle », un exsudat riche en cellules immunocompétentes et en facteurs de croissance se forme, créant un environnement optimal pour la régénération [7]. Dans ce contexte, la cicatrisation ne repose pas uniquement sur un processus de guérison secondaire avec formation de cicatrice. La pulpe digitale peut, dans une certaine mesure, se régénérer, ce qui établit des analogies avec le développement embryologique et la régénération des extrémités dans le règne animal, notamment chez les amphibiens [8].
Comme alternative, des techniques chirurgicales sont disponibles, bien qu’elles soient désormais utilisées beaucoup plus rarement. La prise en charge opératoire repose sur la greffe composite ou les plasties en VY. La fermeture directe avec formation d’un moignon entraîne souvent une altération significative de la fonctionnalité et de l’esthétique. La plastie en lambeau a été décrite pour la première fois par Kutler en 1947 [9]. Cette technique a été modifiée à plusieurs reprises, en intégrant les structures neurovasculaires. Par rapport au traitement conservateur, elle entraîne généralement une incapacité de travail plus longue. De plus, elle présente un risque accru de nécrose ainsi qu’une cicatrisation secondaire avec contracture cicatricielle, ce qui peut altérer la sensibilité. Outre l’hyposensibilité, de nombreux patients rapportent une intolérance au froid [10]. En revanche, les patient.e.s traité.e.s de manière conservatrice avec un pansement en film présentent un risque moindre de développer ces complications [11]. Si un segment amputé intact est disponible (ce qui n’était pas le cas chez notre patient), une replantation peut être envisagée. Cette procédure est techniquement exigeante, car les vaisseaux sont souvent traumatisés. Toutefois, lorsqu’elle est réussie, elle permet d’obtenir d’excellents résultats esthétiques [12]."
Une étude clinique comparant le traitement conservateur au traitement chirurgical a montré que tous les patients traités par pansement en film ont guéri. En revanche, dans le groupe ayant bénéficié d’une prise en charge chirurgicale, une nécrose du lambeau est survenue dans 28 % des cas. Les patients traités de manière conservatrice ont rapporté moins de douleurs, une moindre altération de la discrimination en deux points et une meilleure tolérance au froid par rapport au groupe opéré. Les troubles trophiques étaient également nettement moins fréquents. Ces différences étaient statistiquement significatives et ont conduit à une reprise du travail plus rapide chez les patient.e.s traité.e.s conservativement [11]. Une étude randomisée et contrôlée menée à Strasbourg en 2023 sur 44 patients a toutefois montré un équilibre plus marqué entre les deux approches thérapeutiques. Aucune différence significative concernant la sensibilité n’a été observée. La durée moyenne de guérison avec un pansement en film était de 4,9 semaines [13], tandis qu’une autre étude rapportait une durée moyenne de trois semaines (± 9 jours) [14]. Même en présence de résultats similaires, il est important de considérer que le traitement conservateur évite les risques inhérents à une intervention chirurgicale. Un os exposé ne constitue pas en soi une contre-indication, à condition que les tendons soient intacts. Si l’os dépasse de manière significative, il doit être raccourci, tandis que de petites protubérances peuvent se résorber naturellement sous un pansement occlusif [1]. Le pansement occlusif est particulièrement adapté aux petits hôpitaux régionaux avec des distances de transfert importantes, comme l’Hôpital de Haute-Engadine. L’accès immédiat à une prise en charge spécialisée en chirurgie de la main n’est souvent pas possible et nécessiterait un transfert vers un centre spécialisé.
Ce cas clinique illustre de manière convaincante que, même en présence de lésions traversant une articulation, une récupération fonctionnelle presque complète est possible. Chez notre patient, la seule limitation notable restante est l’ankylose de l’articulation interphalangienne distale (DIP), qui ne le gêne toutefois pas dans sa vie quotidienne. Nous supposons que l’arthrose de Heberden préexistante a été aggravée par la réaction inflammatoire locale induite par la plaie.
La théorie démontre les avantages du pansement semi-occlusif. Toutefois, pour obtenir de bons résultats en pratique, une information détaillée du patient sur le déroulement du traitement, le développement des odeurs et la durée de la prise en charge est essentielle. Le pansement est maintenu en place jusqu’à l’arrêt de toute sécrétion et l’assèchement complet de la plaie. Le traitement peut ainsi sembler long d’un point de vue subjectif, et les pansements peuvent dégager des odeurs désagréables, comme l’a également rapporté notre patient lors du suivi. Pour atténuer cet inconvénient, un nettoyage rigoureux de la peau proximale à la plaie, un changement régulier du pansement ou l’ajout d’une couche intermédiaire contenant du charbon actif peuvent être envisagés [1].
Points importants pour la pratique
Le pansement en film constitue une option efficace et simple à mettre en œuvre pour le traitement des pertes tissulaires étendues des doigts. La présence d’un os ou d’une articulation exposés, ainsi que la présence de matériel de suture in situ, ne constituent pas des contre-indications.
Les résultats, tant objectifs que subjectifs, sont comparables, voire supérieurs, à ceux du traitement chirurgical. En général, la sensibilité et la fonctionnalité sont au moins équivalentes, sinon meilleures. Le résultat esthétique est excellent.
Une information détaillée du patient sur la durée du traitement et la possible émission d’odeurs est essentielle. Lorsqu’il est bien informé, le taux de satisfaction des patients est très élevé.
Remerciements
Nous remercions le patient pour son consentement et sa participation. Nous adressons également nos remerciements au Prof. Dr. Jörg Grünert pour la relecture et son aide dans la recherche de litérature.
Ethics Statement
Un consentement éclairé écrit du patient pour la publication a été obtenu.
Conflict of Interest Statement
Les auteur.e.s déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts potentiel.
- Christen S, Grünert J, Hainich J, Winsauer S. Regeneration nach Fingerkuppenamputation – Möglichkeiten und Limitationen (Teil 2). pädiatrische Prax. 2023;99/3:511–26.
- Hoigné D, Hug U, Schürch M, Meoli M, Von Wartburg U. Semi-occlusive dressing for the treatment of fingertip amputations with exposed bone: Quantity and quality of soft-tissue regeneration. J Hand Surg Eur Vol. 2014;39(5):505–9.
- Lee DH, Mignemi ME, Crosby SN. Fingertip injuries: an update on management. J Am Acad Orthop Surg. 2013 Dec;21(12):756–66.
- Allen MJ. Conservative management of finger tip Injuries in adults. Hand. 1980;12(3):257–65.
- Bossley CJ. Conservative treatment of digit amputations. N Z Med J. 1975 Dec;82(553):379–80.
- De Boer P, Collinson PO. The use of silver sulphadiazine occlusive dressings for finger-tip injuries. J Bone Jt Surg - Ser B. 1981;63(4):545–7.
- Mennen U, Wiese A. Fingertip Injuries Management with Semiocclusive Dressing. J Hand Surg Am [Internet]. 1993 Aug 1;18(4):416–22. Available from: https://doi.org/10.1016/0266-7681(93)90139-7
- Christen S, Grünert J, Hainich J, Winsauer S. Regeneration nach Fingerkuppen- amputation – Möglichkeiten und Limitationen (Teil 1). Chir Prax. 2021;622:606–22.
- Kutler W. A new method for finger tip amputation. J Am Med Assoc [Internet]. 1947 Jan 4;133(1):29–30. Available from: https://doi.org/10.1001/jama.1947.62880010007007
- Martin C, Del Pino JG. Controversies in the treatment of fingertip amputations: Conservative versus surgical reconstruction. Clin Orthop Relat Res. 1998;353(353):63–73.
- Pastor T, Hermann P, Haug L, Gueorguiev B, Pastor T, Vögelin E. Semi-occlusive dressing therapy versus surgical treatment in fingertip amputation injuries: a clinical study. Eur J Trauma Emerg Surg [Internet]. 2023;49(3):1441–7. Available from: https://doi.org/10.1007/s00068-022-02193-6
- Venkatramani H, Sabapathy S. Fingertip replantation: Technical considerations and outcome analysis of 24 consecutive fingertip replantations. Indian J Plast Surg. 2011;44(2):237–45.
- Bensa M, Sapa MC, Al Ansari R, Liverneaux P, Facca S. Semi-occlusive dressing versus surgery in fingertip injuries: A randomized controlled trial. Hand Surg Rehabil. 2023;42(6):524–9.
- Quadlbauer S, Pezzei C, Jurkowitsch J, Beer T, Keuchel T, Hausner T, et al. Der Okklusionsverband zur Behandlung von Allen III und IV Fingerkuppenverletzungen als Alternative zu lokalen Lappenplastiken. Unfallchirurg. 2017;120(11):961–8.
- Hoigne D, Hug U. Amputationsverletzungen am Fingerendglied: Regeneration mittels Folienverband. Swiss Med Forum ‒ Schweizerisches Medizin-Forum. 2014;14(18):356–60.